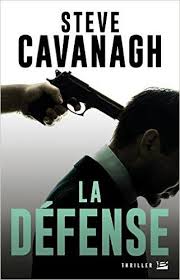Dans le café de la jeunesse perdue
Gallimard, 2007
Paris, 1960. Un café, Le Condé. Des habitués viennent y passer le temps, jouer aux cartes ou discuter, surtout la nuit. Il y a Zacharias, Ali Cherif, la Houpa et les autres. Et il y a Louki.
Ils ne sont pas étudiants, pourtant ils ont élu domicile dans ce bistrot du quartier des écoles. On ne sait pas bien ce qu’ils sont, d’ailleurs. En dehors des cafés de Paris, ils ne sont que des ombres. Louki plus que tous les autres.
Patrick Modiano dresse le portrait de cette jeune femme à travers le prisme de plusieurs personnages : l’étudiant de l’Ecole des mines en marge des habitués du Condé, le mari abandonné, l’amant et Louki elle-même.
Chaque regard témoigne de la fragilité d’une jeunesse sans avenir, d’une éternelle fuite en avant, sans retour possible. D’Auteuil à Pigalle, de Neuilly au Quartier latin, le roman nous entraîne dans le dédale des rues parisiennes ; ce sont des rues sombres, nimbées d’une épaisse couche de nostalgie.
Cinquante ans plus tard, ces rues ont bien changé. Patrick Modiano l’évoque, d’ailleurs. Le Condé a disparu à jamais, à sa place se trouve à présent une maroquinerie de luxe. Que reste-il de ceux qui ont aimé Louki dans le passé ? Dans le café de la jeunesse perdue porte bien son nom.
« Un jour que je sortais avec Louki de la station de métro Mabillon – un jour de novembre vers six heures du soir, la nuit était déjà tombée – elle a reconnu quelqu’un assis à une table derrière la grande vitre de La Pergola. Elle a eu un léger mouvement de recul. Un homme d’une cinquantaine d’années, au visage sévère et aux cheveux bruns plaqués. Il nous faisait presque face et lui aussi aurait pu nous voir. Mais je crois qu’il parlait à quelqu’un à côté de lui. Elle m’a pris le bras et m’a entraîné de l’autre côté de la rue du Four. Elle m’a dit qu’elle avait connu ce type deux ans auparavant avec Jeannette Gaul et qu’il s’occupait d’un restaurant dans le IX° arrondissement. Elle ne s’attendait pas du tout à le retrouver ici, sur la rive gauche. »
=> Quelques mots sur l’auteur Patrick Modiano
=> Autre avis sur Dans le café de la jeunesse perdue : Du temps pour lire