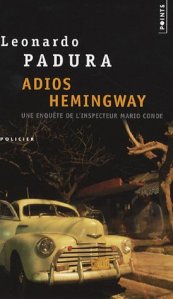Bernard Massoubre
Le diable se cache dans les détails
L’Astre Bleu Editions – 2021
Un avocat assassiné dans les rues de Lyon, une enquête de police, les ingrédients indispensables à la construction d’un polar bien du genre sont réunis. Moi qui ne lis que peu de polars, je me suis rapidement monté un film dans ma tête de caboche. On ne me la fera pas à moi, je ne tomberai pas dans le panneau, je ne serai pas manipulée et résisterai à l’envie de chercher l’assassin parmi les personnages secondaires les plus arrogants ou les plus ternes de l’histoire. Bernard Massoudre, s’il lit mes mots, rira bien de ma propre arrogance, j’en suis certaine. Car Le diable se cache dans les détails n’a pas grand-chose d’un polar traditionnel. Je ne l’aurais pas classé dans cette catégorie, d’ailleurs, mais plutôt dans les romans de société. Il y a meurtre, il y a enquête, mais il y a surtout description d’un milieu social, de la dépravation institutionnalisée de toute un pan de la société. Le roman est d’autant plus intéressant pour moi que l’histoire se passe à Lyon. Dans ma ville, donc.
La postface du livre en explique l’origine et justifie sa profondeur. Faut-il l’évoquer ici, ou laisser le lecteur comprendre seul son essence autobiographique ? J’opte pour le silence pour respecter la construction du roman, même si l’envie d’évoquer le sujet de fond me démange. Bernard Massoudre assume l’objectif expiatoire de son œuvre, en assume aussi la part de fiction. Si le témoignage est présent derrière les mots, l’histoire est imaginaire. C’est cette double facette qui rend l’histoire intéressante.
Ceux qui lisent mes chroniques connaissent ma franchise. Le style du Diable se cache dans les détails pourrait être plus abouti. Mais il faut comprendre les raisons de l’écriture et la pertinence du sujet, aussi tentons de dépasser ce défaut. Derrière les maladresses d’écriture se devine l’âme de Bernard Massoudre, un projet dicté par l’urgence, une écriture nécessaire et libératrice. Il a fallu bien du courage à l’auteur pour écrire, croyez-moi. Ce livre, c’est au-delà du coup de gueule. C’est un knock-out. Le lecteur suit une enquête qui le conduit dans les bas-fonds de la notabilité lyonnaise, celle qui parait si froide aux Lyonnais venus d’ailleurs. Nous autres ne serons jamais introduits dans le milieu et finalement, c’est tant mieux. Vous l’aurez deviné, ce roman est une formidable dénonciation d’un monde à la dérive. Bernard Massoudre ne fait de cadeau à personne. Chefs d’entreprise, avocats, grenouilles de bénitier, la belle façade bien-pensante est grattée impitoyablement. Le masque se lézarde. Les beaux quartiers d’Ainay et les villas des bords de Saône sont décortiqués au peigne fin. La fiction au service de la sociologie. Le diable se cache dans les détails, c’est une visite guidée d’un Lyon que je ne connaissais pas et, qu’après cette lecture, je n’ai aucune envie de connaître.
=> Quelques mots sur l’auteur Bernard Massoubre