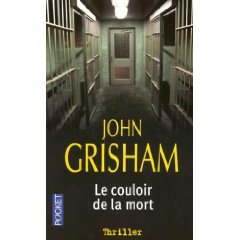Jean Haechler
Jean Haechler
Bathazar Grimod de la Reynière
Un gastronome à la table des lumières
Editions Séguier – 2016
Balthazar Grimod de la Reynière (1758-1837) était un bien étrange personnage. S’il fallait le résumer en quelques mots, ce serait impossible. Essayons tout de même une synthèse, si mauvaise soit-elle, des 278 pages écrites par Jean Haechler : de naissance noble, Balthazar Grimod de la Reynière a été (entre autres) philosophe, épicurien, critique d’art, guide gastronomique, avocat et épicier. N’oublions pas, essentiel, d’évoquer aussi son infirmité : Balthazar Grimod de la Reynière est né sans mains.
Rejeté par ses parents, esprit brillant, notre homme a vécu toute sa vie dans un anticonformisme facilité par l’opulence financière de ses parents. Il ne voulait peut-être pas épouser la noblesse de cour à laquelle appartenait sa mère mais n’a pas pour autant refusé de puiser dans les deniers familiaux. Opportuniste, Balthazar ?
Rejeté par les femmes, il a développé une misogynie féroce qui se lit dans de nombreux propos que cite Jean Haechler. Mesdames, si vous n’êtes ni actrice, ni belle, vous n’avez aucune chance de l’intéresser, ni lui ni aucun de ses amis. Faites-en le deuil tout de suite, ça vaudra mieux.
Passionné d’art, de théâtre en particulier, à vingt-trois ans il est devenu membre de l’Académie des Arcades de Rome où siégeaient déjà Fontenelle et Voltaire. Quelques extraits de ses critiques de pièces et de jeux d’acteurs figurent dans la biographie ; on aimerait en savoir davantage, tant elles brillent par leur spiritualité et la profondeur de leur contenu.
Avocat, après un grand scandale auquel il s’est bêtement mêlé, ses parents l’ont exilé dans un couvent puis à Lyon où il s’est essayé au commerce, ce qui a sauvé sa tête pendant la Terreur.
Et tout au long de sa vie, gourmand à l’instar de son grand-père et de son père, il a toujours défendu la bonne chair, jusqu’à créer un jury dégustateur de renommée internationale, écrire un Almanach des Gourmands et divers autres textes consacrés aux règles de l’art culinaire, de la table ou de l’hospitalité. La deuxième partie de la biographie est exclusivement consacrée à ces ouvrages.
La vie du héros, mouvementée, se prête volontiers à une écriture vive et envolée. Jean Haechler a réussi à éviter les propos dogmatiques et a rendu son texte vivant et même passionnant. Il a rassemblé une masse documentaire énorme et s’en est servi à profusion pour enrichir son récit. Quel régal ! Les références aux écrits de Grimod de la Reynière sont légion mais l’historien puise ses sources également au sein des lettres rédigées par certains des amis du gastronome, voire, en citant toujours ses sources, au sein de biographies antérieures à la sienne.
Je formulerais tout de même une critique et hélas, elle est de taille, même si elle s’adresse à l’éditeur Séguier et non à l’auteur : la taille des caractères choisis pour l’impression, en particulier dans les extraits de lettres (et ils sont nombreux), est tellement petite qu’il m’était tout simplement impossible de lire l’ouvrage à la lumière artificielle. Les notes de bas de page, intéressantes au point qu’elles auraient pu être intégrées au corps du texte, sont encore plus petites. J’ai dû, avec beaucoup de regret, abandonner la lecture de certaines d’entre elles en raison de la fatigue visuelle qu’elles m’ont occasionnées.
Voici, pour l’agrément de ma chronique, quelques citations issues des écrits de Grimod de la Reynière et repris par Jean Haechler. Elles ne manquent pas de piment. Je les ai choisies dans le strict domaine de la gourmandise façon Grimod, dans le but de parfaire les qualités d’hôte de chacun de mes lecteurs et leur rappeler quelques règles élémentaires de l’art de la gastronomie, pour le cas où elles leur auraient échappé !
« Est-il une femme, tant jolie que vous la supposiez, eut-elle la tête de Mme Récamier, le port de Mlle George Weimer, les grâces enchanteresses de Mme Henri Belmont, l’éclat et l’appétissant embonpoint de Mlle Emilie Contat, la bouche et le sourire de Mlle Arsène, etc. etc. qui puisse valoir ces admirables perdrix de Cahors, du Languedoc et des Cévennes, dont le fumet divin l’emporte sur tous les parfums de l’Arabie ? »
« Il est rare que l’on prie des dames à déjeuner ; si l’on y admet quelques-unes, ce sont, ou des femmes galantes, ou des dames très indulgentes à tout ce qui tient à l’étiquette ; car un déjeuner n’est agréable qu’autant qu’on en a banni toute espèce de gêne : c’est pour cela qu’on ne permet jamais aux valets d’y paraître. »
« Il n’est pas moins nécessaire d’avoir les pieds chauds tandis qu’on mange. Des boules d’étain remplies d’eau à 60 degrés, et qui, incrustées dans le plancher, feraient exactement le tour de la table, nous paraissent un moyen sûr d’entretenir cette partie du corps, qui influe si puissamment sur les organes de la digestion, dans le degré de chaleur qu’elle doit toujours avoir sur les gourmands. »
« Il est important de faire ici une observation sur l’énonciation de l’heure. Il existe à Paris trois manières de la déterminer, qu’il est bon de connaître afin de n’arriver ni trop tôt, ni trop tard. Ainsi cinq heures par exemple signifie six heures ; cinq heures précises, cinq heures et demie ; et cinq heures très précises, cinq heures. Avec cette règle invariable, l’on ne se trompera point et l’on ne fera jamais attendre. »
« Les morceaux [de tête de veau] les plus distingués sont d’abord les yeux, ensuite les bajoues, puis les tempes, puis les oreilles, enfin la langue que l’on met ordinairement sur le gril, panée et sous une sauce appropriée. On a soin de servir avec chacun des morceaux ci-dessus désignés, une portion de la cervelle qu’on puise dans le crâne, dont la partie supérieure a dû être enlevée avant de mettre sur table. »
« Les truffes ne sont, à Paris, réellement bonnes, (c’est-à-dire parfaitement mûres et éminemment parfumées) que vers les fêtes de Noël, après les premières fortes gelées ; plus tôt, elles ne sont pas encore mûres, et n’ont guère plus de saveur que des morilles. Laissons donc aux petits-maîtres ignorants, aux gourmets imberbes, aux palais sans expérience, la petite gloriole de manger les premières truffes. »
=> Quelques mots sur l’auteur Jean Haechler