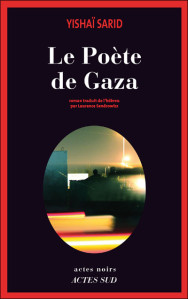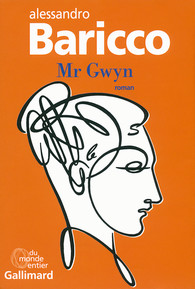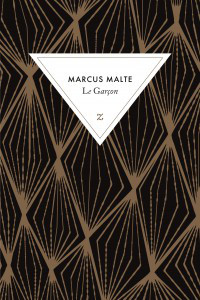Et puis, Paulette…
Calmann-Levy – 2012
Bienvenue chez les Bisounours ! L’expression est d’usage courant depuis quelques années maintenant ; peut-être que c’est ce roman qui en a développé l’usage. Même moi qui suis particulièrement idéaliste, j’ai trouvé que trop c’est trop…
Nous suivons Ferdinand, retraité solitaire depuis le décès de sa femme. Il habite une vaste ferme aux pièces inoccupées. Il a pourtant plein d’amour à donner. Un cœur généreux qui n’aspire qu’au partage. Le hasard le met sur le chemin de Marceline, une voisine qu’il ne connaissait que de vue et qui, elle, vit dans une petite fermette dont le toit s’effondre. L’homme généreux offre l’hospitalité à la femme effondrée, le temps de faire intervenir le couvreur. Bientôt, après Marceline, d’autres égarés de la vie vont venir habiter chez Ferdinand. La ferme reprend doucement vie.
Je crois avoir tout dit sur ce roman dans mon premier paragraphe… Trop linéaire, trop lisse. J’en comprends les bonnes intentions. Dans un monde idéal, le partage sera roi. Les initiatives dans ce sens, aujourd’hui, ne manquent pas, heureusement. Mais tout de même… Pas un accroc, pas une égratignure ne semble atteindre les habitants de la ferme-auberge espagnole. Ils sont malheureux, ils s’installent, ils en sont transformés, ils accueillent l’éclopé suivant. Ce n’est même pas de l’utopie, ça. L’utopie est un moteur pour aller de l’avant. Elle doit être pimentée par un peu de piquant, des écueils, des difficultés à surmonter. Dans Et puis, Paulette…, les problèmes ne sont même pas évoqués. De la guimauve, rien que de la guimauve.
Que dire du style ? Le langage est vivant et rythmé. Plein de charme pour qui accepte les écrits en style familier. Dans ce roman, narration comme dialogues, toute la sauce est écrite dans ce style elliptique. Au bout de quelques pages, c’est insupportable. Où est la recherche dans l’écriture, le vocabulaire un peu soutenu, les phrases bien tournées ? Un roman ne doit-il pas aussi servir sa langue ? Le roman est donc frais, certes, mais dans deux jours, j’aurai complètement oublié jusqu’à son existence.
C’est dommage. Le sujet traité est pourtant essentiel. De plus en plus de projets collectifs émergent, terrains d’expérimentation des enjeux sociétaux de demain. Il faut les évoquer pour les mettre à la portée de tous. Hélas, l’approche de Barbara Constantine ne conduit pas, à mon sens, à développer ce type d’initiatives, plutôt le contraire : car l’auteure oublie d’en évoquer les freins, les revers ou les points de blocage. Avec ce roman, l’utopie n’a aucune chance de se transformer en réalité. Elle n’est tout simplement pas crédible.
=> Quelques mots sur l’auteur Barbara Constantine