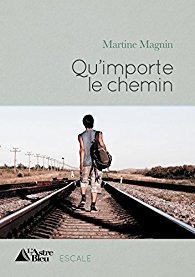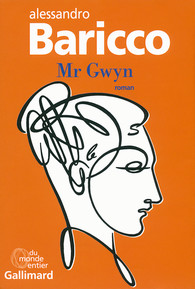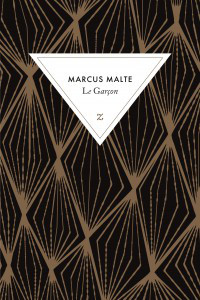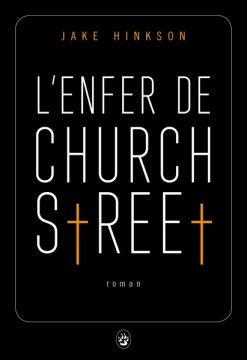Traductrice : Denise Getzler
Mansfield Park
Christian Bourgeois Editeur – 1982
Je me suis promis de chroniquer chacun des romans de Jane Austen. Mansfield Park est le troisième auquel je m’attèle. Ce n’est pas le plus simple, tant ce roman sort de la veine des autres (je mets son roman épistolaire non terminé, Lady Susan, de côté). En effet, si les cinq autres grands récits encensent l’amour véritable, celui-ci met plutôt l’accent sur l’amour vénal, l’hypocrisie et la perversion.
Lisez plutôt.
Une jeune femme est plus aimable lorsqu’elle est fiancée que lorsqu’elle est libre. Elle a tout lieu de s’en féliciter. Ses soucis sont terminés, et elle sent qu’elle peut déployer tous ses talents de séduction sans éveiller de soupçons. On ne risque rien quand une lady est fiancée ; il ne peut rien arriver de mal.
Si Sir Thomas était pleinement décidé à être conséquemment le vrai protecteur de l’enfant choisi, madame Norris n’avait, elle, pas la moindre intention de délier sa bourse pour subvenir à ses besoins. Etait-il question de marche, de conversation ou de manigances, elle se montrait des plus charitables, et personne mieux qu’elle ne savait dicter aux autres leur libéralité : mais son amour de l’argent égalait son amour de l’autorité, et elle savait tout aussi bien épargner le sien que dépenser celui de ses amis.
De tous les personnages austéniens, ceux de Mansfield Park sont probablement les plus proches de notre époque. La trame de l’histoire a quelque chose de machiavélique, de malsain, loin de la bienséance tranquille des milieux nobles du dix-neuvième siècle qui sont d’habitude décrits. Une forme de féminisme s’en dégage, même si l’auteur la déplore, probablement trop ancrée dans son modèle social pour pouvoir s’en libérer. On est plus proche des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos (ambiance que l’on retrouve encore plus dans Lady Susan) que de la divine amourette d’Orgueil et préjugés, qui ne doit vaincre que les différences de classe, pas les obstacles moraux.
La morale est sauve pourtant dans Mansfield Park, mais il s’en faut de peu. Jane Austen a-t-elle souhaité transmettre un message quelconque avec le happy end final ou seules les convenances de l’époque l’ont amenée à cette fin heureuse ? Je n’ai hélas pas la réponse, seulement la certitude que ce roman, pour moi, a une place particulière dans l’œuvre de la grande romancière.