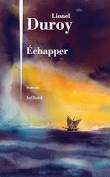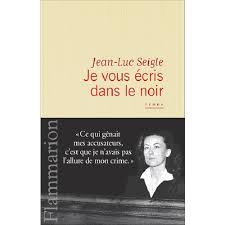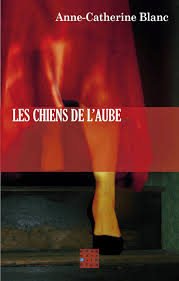Les intéressants
Éditions rue fromentin, 2015
Voilà un roman qui me laisse bien perplexe. Je suis partagée entre deux sentiments : celui de ne pas y avoir trouvé d’intérêt et celui d’être convaincue que je ne l’oublierai pas facilement. Quel paradoxe !
Les intéressants raconte l’adolescence et la maturité de six américains de New-York entre 1977 et aujourd’hui. Ash, Cathy, Jules, Ethan, Goodman et Jonah se rencontrent dans un camp de vacances découvreur de talents, Spirits-in-the-woods. Ils y forment un club, le club des intéressants justement. Seuls les aléas de la vie arriveront à les séparer au cours des décennies qui suivront.
Meg Wolitzer décrit les succès, les échecs et les combats intérieurs de ses héros, à travers le regard de trois d’entre eux, Ash, Ethan et Jules. Ash et Ethan symbolisent la réussite professionnelle, sociale et financière. Jules, observatrice des succès de ses amis, un brin jalouse, a une vie beaucoup plus standard. Seule la générosité de ses amis lui permettra de rester habiter dans New York, contrairement à de milliers de banlieusards.
Tout au long des 564 pages que dure ce récit, le lecteur va être témoin des joies, drames et échecs des différents personnages. De nombreux sujets de société sont abordés : l’adolescence, la sexualité, les liens de famille, la maladie, l’abus d’autrui. Des sentiments comme le doute, la douleur, la générosité, la jalousie. Ce livre est un hymne à l’introspection, à l’amitié et à l’amour.
L’histoire ne manque pas d’intérêt. Je me suis surprise à comparer le livre à un film de Woody Allen des années 1975-1980. Et c’est peut-être par là qu’il pêche : il est tellement psychanalytique, tellement new-yorkais qu’il pourrait passer pour synopsis d’un film du grand cinéaste américain. Seulement un film se visionne en deux heures, tandis qu’un roman d’une telle longueur se lit en plusieurs jours.
Pour résumer, Les intéressants est un bon livre psychanalytique, mais sa longueur lui fait perdre de sa force.