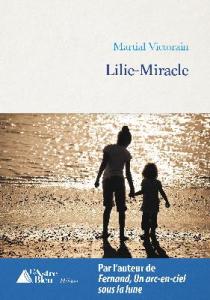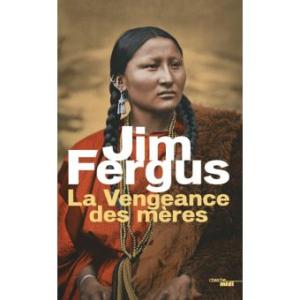Le Jour d’avant
Grasset, 2017
Raconter Sorj Chalandon et son style inimitable avec mes mots à moi ? C’est la troisième fois que je pratique l’exercice, c’est la troisième fois que je sens l’ampleur du fossé qui sépare mes prouesses narratives de celles du journaliste.
Raconter l’indicible. Sorj Chalandon sait le faire. Il a déjà tâté le terrain en expliquant l’Irlande et ses désolations (Retour à Killybegs, 2011) ou en s’invitant dans l’intimité de la violence d’un père envers son fils (Profession du père, 2015). Avec Le Jour d’avant, c’est la tragédie de la mine de charbon de Saint-Amé de Liévin le 27 décembre 1974 qu’il utilise comme sujet d’étude.
Une explosion dans la fosse 3bis endeuille quarante-deux familles. La mort de Joseph Flavent secoue son frère au point que quarante ans plus tard, il passe encore une grande partie de son temps dans le mausolée qu’il a construit au nom de Joseph et de ses collègues disparus. Va-t-il finir par pouvoir tourner la page ?
Ce livre se lit comme une plaie ouverte qui saigne abondamment. Etre mineur sonne comme une condamnation à mort. Mort souterraine ou asphyxie à petit feu au bout de quarante ans de loyaux services, quelle différence ? Un petit rappel historique sur l’avènement de la médecine du travail s’impose ici. C’est en 1946 qu’ont été nommés les premiers médecins du travail, dans l’objectif de dépister la silicose chez les mineurs dans le nord de la France. Cette maladie détruit les poumons au point de leur faire perdre leur capacité d’absorber l’oxygène. Il s’agit de la première maladie reconnue comme professionnelle en France. Cette reconnaissance avait pour objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés. D’assainir l’air des mines afin de protéger leur santé. Fin 1974, dans la mine de Saint-Amé de Liévin, cet objectif a-t-il été atteint ? L’auteur, bien qu’il ne traite pas la question sous cet angle-là, semble penser que non. Ce qui a tué les quarante-deux mineurs de fond, c’est l’accumulation de poussière, l’absence de ventilation efficace, le non-respect de l’arrosage des couloirs et la course au rendement. Autant de dysfonctionnements qui ont permis l’explosion. Si les victimes avaient survécu, elles auraient succombé quelques années plus tard à la maladie.
Raconter l’indicible ? Dans ce roman, il s’agit de raconter ce qui se passe dans le cœur pétrifié de Michel Flavent, frère de Joseph, condamné par son père à venger la famille de toutes ses victimes de la mine. Ce roman crie la douleur de l’absence dans chaque mot. Des trois romans de l’auteur que j’ai lus, c’est le plus difficile à lire. Celui où la plaie est la plus à vif. Celui où le non-dit est aussi présent entre les lignes que les souffrances exprimées. Le rythme est lent dans la première moitié. Il faut prendre du temps pour digérer les informations. Puis arrive le moment de bascule où les évènements s’accélèrent. Le rythme des mots ne change pas, mais le rythme cardiaque du lecteur, si. L’horreur de la tragédie prend une autre dimension, plus intime, plus triste encore.
Dure et belle lecture, que celle de Le Jour d’avant. J’attends votre nouveau sujet avec hâte, Monsieur Chalandon.
=> Quelques mots sur l’auteur Sorj Chalandon