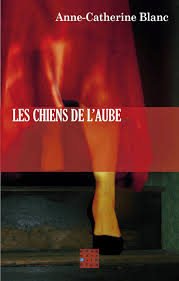Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin
Grasset, 2015
« Prenez une profonde inspiration, soufflez. » Dès les premières lignes de son roman, Tania de Montaigne prend le lecteur à témoin et l’invite à se plonger dans la vie des noirs des années 1950. Ceux des états sudistes des États-Unis, bien sûr. A Montgomery, la ville de légende où Martin Luther King et Rosa Parks ont combattu côte à côte pour dénoncer les lois ségrégationnistes d’Alabama.
Il n’est pas besoin de présenter Martin Luther King. Rosa Parks non plus, tout le monde en a entendu parler sur les bancs de l’école : un jour elle a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus, ce qui a conduit les noirs à se mobiliser enfin. Et Claudette Colvin, la connaissez-vous ?
« Prenez une profonde inspiration, soufflez. » Tania de Montaigne nous prend par la main pour nous mener à la rencontre de cette adolescente qui a été la première à refuser de libérer sa place assise dans un bus au profit d’un blanc, quelques mois avant Rosa Parks. Elle a été inculpée pour cette forfaiture et a plaidé non coupable. Une grande première. Pourtant, l’émotion générée par son courage et sa condamnation est retombée comme un soufflet de forge au bout de quelques semaines. Car Claudette Colvin n’était pas la victime idéale. Condamnée injustement, elle s’est enfermée sur elle-même et a fauté avec un homme un peu trop blanc. En 1955 dans l’Amérique ségrégationniste, toute lutte des noirs contre les blancs doit présenter des garanties morales. Claudette Colvin, enceinte suite à cette liaison malheureuse, n’apportait pas ces garanties, contrairement à Rosa Parks.
Dans Noire, Tania de Montaigne retrace l’histoire de ce formidable combat que les enseignants continueront à transmettre aux enfants. Mais elle en écrit aussi la face cachée. Toute révolution a ses victimes. Et si Rosa Parks a eu droit à un deuil national à son décès, Claudette Colvin disparaîtra dans l’oubli, emportée par la puissance de Jim Crow, le cliché du noir grotesque, inventé au dix-neuvième siècle et repris par de nombreux comiques au vingtième siècle.
Tania de Montaigne écrit dans un style dynamique qui entraîne le lecteur, presque malgré lui, dans son tourbillon de révolte. Dès la première seconde où il a jeté ses yeux sur le roman, elle l’agrippe fermement à la manche et ne le lâche plus. « Prenez une profonde inspiration, soufflez. » Mais elle ne laisse pas souffler. Elle ne veut pas que les luttes vaines et injustes des minorités tombent dans l’oubli. Le rythme qu’elle donne à son essai est tellement soutenu que le récit en manque de profondeur, ce qui est dommage. On trouve dans Noire l’essentiel qu’il faut retenir de cette page de l’histoire des hommes, mais pas plus. Un travail de journaliste.