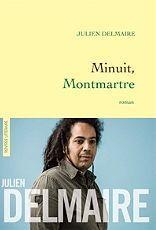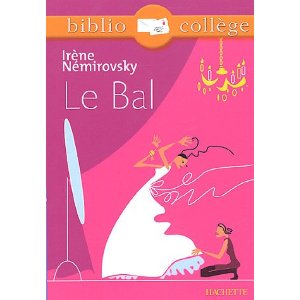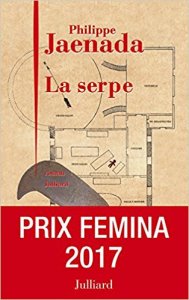Nikolaï Leskov
Nikolaï Leskov
Traducteur : Jacques Imbert
Le paon
Editions de l’Aube – 2018
Première parution – 1874
Pavline Petrovitch, ancien serf, a acheté sa liberté et est entré au service d’une propriétaire d’un immeuble moscovite, Anna Lvovna, comme majordome. Il assume son rôle avec une rigueur psychorigide, jusqu’à faire retirer les fenêtres des locataires mauvais payeurs puis mettre ces derniers à la porte sans autre sommation s’ils ne s’acquittent pas rapidement de leur loyer. Sa vie va basculer le jour où une famille de la noblesse appauvrie emménage dans un des appartements. Trois femmes la composent : une grand-mère, une mère et une fillette. Les deux femmes finissent par mourir, laissant la petite, Liouba, orpheline. Pavline propose de la prendre à sa charge.
La structuration de ce court récit n’a pas été sans me rappeler Stephan Zweig et 24 heures de la vie d’une femme (1927). Tout comme Zweig, Leskov utilise ici un personnage secondaire pour raconter l’histoire de Pavline à un groupe d’inconnus. Le récit est centré sur sa vie et celle de Liouba, sans fioritures, sans aucune description de l’environnement. Les évènements, rien que les évènements, de manière factuelle et un brin psychologique.
J’ai été étonnée par la richesse de ce court récit. La séparation des classes en est un élément essentiel. Pavline Petrovitch est issu de la servitude, puis devient majordome, « suisse » comme se plait à le nommer Anna Lvovna. Toute sa vie, il conservera cette étiquette gravée sur son front. Elle lui dictera son humilité, justifiera le piédestal sur lequel il place Liouba, expliquera son refus de se déclarer lorsqu’il tombe amoureux de sa pupille. Anna Lvovna et Liouba le lui rendront bien, d’ailleurs, l’une en se servant de lui dans ses desseins personnels, l’autre en le méprisant pour ce qu’il accepte d’être.
Subtilement, un autre sujet d’importance vient se rajouter au récit : la religion. Toute la vie de Pavline est dictée par des préceptes religieux. Ce n’est pas perceptible au début, tant le zèle du serviteur prime sur sa nature propre. Mais plus il se libère de la servitude de vassal pour tomber dans la maritale, plus ses actes sont charitables. Une charité de la plus belle eau, faite de dévouements et de sacrifices. Pavline reste dans l’ombre, mais de cette ombre il agit et transfigure ceux qui lui sont liés par le destin.
Je découvre Nikolaï Leskov avec Le paon. D’après ma recherche bibliographique, le clergé semble être un élément important de son univers littéraire. Dans certaines de ses œuvres, il en dénonce le vide et l‘absence de charité. Ici, c’est la débauche qui est dénoncée au contraire et la religion est vue comme l’unique moyen de rédemption.
Intéressant petit ouvrage qui renoue mon intérêt pour la littérature russe.
=> Quelques mots sur l’auteur
Nikolaï Leskov
Traducteur : Jacques Imbert
Le paon
Editions de l’Aube – 2018
Première parution – 1874
Pavline Petrovitch, ancien serf, a acheté sa liberté et est entré au service d’une propriétaire d’un immeuble moscovite, Anna Lvovna, comme majordome. Il assume son rôle avec une rigueur psychorigide, jusqu’à faire retirer les fenêtres des locataires mauvais payeurs puis mettre ces derniers à la porte sans autre sommation s’ils ne s’acquittent pas rapidement de leur loyer. Sa vie va basculer le jour où une famille de la noblesse appauvrie emménage dans un des appartements. Trois femmes la composent : une grand-mère, une mère et une fillette. Les deux femmes finissent par mourir, laissant la petite, Liouba, orpheline. Pavline propose de la prendre à sa charge.
La structuration de ce court récit n’a pas été sans me rappeler Stephan Zweig et 24 heures de la vie d’une femme (1927). Tout comme Zweig, Leskov utilise ici un personnage secondaire pour raconter l’histoire de Pavline à un groupe d’inconnus. Le récit est centré sur sa vie et celle de Liouba, sans fioritures, sans aucune description de l’environnement. Les évènements, rien que les évènements, de manière factuelle et un brin psychologique.
J’ai été étonnée par la richesse de ce court récit. La séparation des classes en est un élément essentiel. Pavline Petrovitch est issu de la servitude, puis devient majordome, « suisse » comme se plait à le nommer Anna Lvovna. Toute sa vie, il conservera cette étiquette gravée sur son front. Elle lui dictera son humilité, justifiera le piédestal sur lequel il place Liouba, expliquera son refus de se déclarer lorsqu’il tombe amoureux de sa pupille. Anna Lvovna et Liouba le lui rendront bien, d’ailleurs, l’une en se servant de lui dans ses desseins personnels, l’autre en le méprisant pour ce qu’il accepte d’être.
Subtilement, un autre sujet d’importance vient se rajouter au récit : la religion. Toute la vie de Pavline est dictée par des préceptes religieux. Ce n’est pas perceptible au début, tant le zèle du serviteur prime sur sa nature propre. Mais plus il se libère de la servitude de vassal pour tomber dans la maritale, plus ses actes sont charitables. Une charité de la plus belle eau, faite de dévouements et de sacrifices. Pavline reste dans l’ombre, mais de cette ombre il agit et transfigure ceux qui lui sont liés par le destin.
Je découvre Nikolaï Leskov avec Le paon. D’après ma recherche bibliographique, le clergé semble être un élément important de son univers littéraire. Dans certaines de ses œuvres, il en dénonce le vide et l‘absence de charité. Ici, c’est la débauche qui est dénoncée au contraire et la religion est vue comme l’unique moyen de rédemption.
Intéressant petit ouvrage qui renoue mon intérêt pour la littérature russe.
=> Quelques mots sur l’auteur
Nikolaï Leskov
Traducteur : Jacques Imbert
Le paon
Editions de l’Aube – 2018
Première parution – 1874
Pavline Petrovitch, ancien serf, a acheté sa liberté et est entré au service d’une propriétaire d’un immeuble moscovite, Anna Lvovna, comme majordome. Il assume son rôle avec une rigueur psychorigide, jusqu’à faire retirer les fenêtres des locataires mauvais payeurs puis mettre ces derniers à la porte sans autre sommation s’ils ne s’acquittent pas rapidement de leur loyer. Sa vie va basculer le jour où une famille de la noblesse appauvrie emménage dans un des appartements. Trois femmes la composent : une grand-mère, une mère et une fillette. Les deux femmes finissent par mourir, laissant la petite, Liouba, orpheline. Pavline propose de la prendre à sa charge.
La structuration de ce court récit n’a pas été sans me rappeler Stephan Zweig et 24 heures de la vie d’une femme (1927). Tout comme Zweig, Leskov utilise ici un personnage secondaire pour raconter l’histoire de Pavline à un groupe d’inconnus. Le récit est centré sur sa vie et celle de Liouba, sans fioritures, sans aucune description de l’environnement. Les évènements, rien que les évènements, de manière factuelle et un brin psychologique.
J’ai été étonnée par la richesse de ce court récit. La séparation des classes en est un élément essentiel. Pavline Petrovitch est issu de la servitude, puis devient majordome, « suisse » comme se plait à le nommer Anna Lvovna. Toute sa vie, il conservera cette étiquette gravée sur son front. Elle lui dictera son humilité, justifiera le piédestal sur lequel il place Liouba, expliquera son refus de se déclarer lorsqu’il tombe amoureux de sa pupille. Anna Lvovna et Liouba le lui rendront bien, d’ailleurs, l’une en se servant de lui dans ses desseins personnels, l’autre en le méprisant pour ce qu’il accepte d’être.
Subtilement, un autre sujet d’importance vient se rajouter au récit : la religion. Toute la vie de Pavline est dictée par des préceptes religieux. Ce n’est pas perceptible au début, tant le zèle du serviteur prime sur sa nature propre. Mais plus il se libère de la servitude de vassal pour tomber dans la maritale, plus ses actes sont charitables. Une charité de la plus belle eau, faite de dévouements et de sacrifices. Pavline reste dans l’ombre, mais de cette ombre il agit et transfigure ceux qui lui sont liés par le destin.
Je découvre Nikolaï Leskov avec Le paon. D’après ma recherche bibliographique, le clergé semble être un élément important de son univers littéraire. Dans certaines de ses œuvres, il en dénonce le vide et l‘absence de charité. Ici, c’est la débauche qui est dénoncée au contraire et la religion est vue comme l’unique moyen de rédemption.
Intéressant petit ouvrage qui renoue mon intérêt pour la littérature russe.
=> Quelques mots sur l’auteur Nikolaï Leskov